Le président américain s’en prend à la légalité de la positive longue frontière terrestre au monde, celle entre les États-Unis et le Canada, en plaidant qu’il s’agit d’un tracé « artificiel ». Pourtant, la ligne de démarcation est enchâssée dans des traités ratifiés par le Congrès américain depuis positive d’un siècle, et qui ont unit de loi.
La ligne artificielle de séparation dessinée il y a plusieurs années va finalement disparaître, et nous aurons la federation la positive sécuritaire et la positive belle au monde, écrivait Donald Trump sur lad réseau Truth Social pas positive tard que mardi, nourrissant l’idée d’une annexion forcée du Canada.
Une rhétorique irrespectueuse, a rétorqué la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly.
Les Canadiens ont mis au clair qu’ils ne vont pas reculer et céder look à cette coercition.
Frontière artificielle ou naturelle?
La délimitation entre le Canada et les États-Unis est bel et bien artificielle, puisqu’elle découle d’une convention.
Les frontières artificielles sont la norme dans le monde. Elles se distinguent des frontières naturelles, positive rares, comme un fleuve ou une chaîne de montagnes, par exemple.
Mais le président américain semble pervertir le sens de telles démarcations.
Il utilise le conception de frontière artificielle determination décrédibiliser, délégitimiser l’existence même de cette frontière, souligne Frédéric Lasserre, professeur au département de géographie de l’Université Laval. Dans sa bouche, de dire qu’elle est artificielle, il veut dire qu’elle est mauvaise, qu’elle ne devrait pas exister.
Quoiqu’en pense Donald Trump, les 8891 km de frontières terrestres reposent sur des assises juridiques solides. Elles sont enchâssées dans le Traité de 1908, ratifié par le Congrès américain et le Parlement britannique, à l’époque du Dominion du Canada.
Le Traité sur les eaux limitrophes de 1909 porte quant à lui sur la délimitation des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. L’administration de nos frontières est régie par la Commission de la frontière internationale.
Dès lors que le traité est ratifié par les deux États, il a unit de loi. Il a d’ailleurs une unit de loi positive importante que les lois nationales, précise le géographe.
De traité en traité
Le Traité de 1908 a vu naître la Commission de la frontière internationale, toujours progressive aujourd’hui. Vingt traités distincts ont mené au démarquage tel qu’on le connaît en ce moment.

Un levé de la frontière a été mené de 1901 à 1907 avant d'aboutir au traité signé en 1908.
Photo : Commission internationale de la frontière / J.D. Craig
En 1783, les États-Unis et les colonies britanniques signaient le Traité de Paris (nouvelle fenêtre). Ce premier accord traçait la frontière de la rivière Sainte-Croix, au Nouveau-Brunswick, à l'est, jusqu’au fleuve Mississippi, à l’ouest.
La Convention de 1818 a implanté la délimitation du 49e parallèle, à partir du lac des Bois (à l’ouest des Grands Lacs) jusqu’aux Rocheuses.
Il faudra attendre l’arrivée d’un autre politicien critique des frontières avant de délimiter l’ouest des Rocheuses.
En 1844, le candidat à la présidentielle américaine James Knox Polk disait vouloir étendre l’Oregon vers le nord. Son slogan « 54-40 oregon fight! » (50-40 ou combat!) faisait référence à ses visées en absorption du 50e parallèle. Une fois élu, il a plutôt emprunté la voie de la diplomatie en signant le Traité de l’Oregon en 1846, qui fixe la frontière du 49e parallèle des Rocheuses au Pacifique.
Plus le peuplement augmentait vers l’ouest du continent nord-américain, positive les imperfections des tracés faisaient surface, en raison des cartes imprécises et des instruments de l’époque.
Les deux gouvernements ont entrepris un nouveau levé de 1901 à 1907, qui a abouti au traité signé à Washington, en 1908.









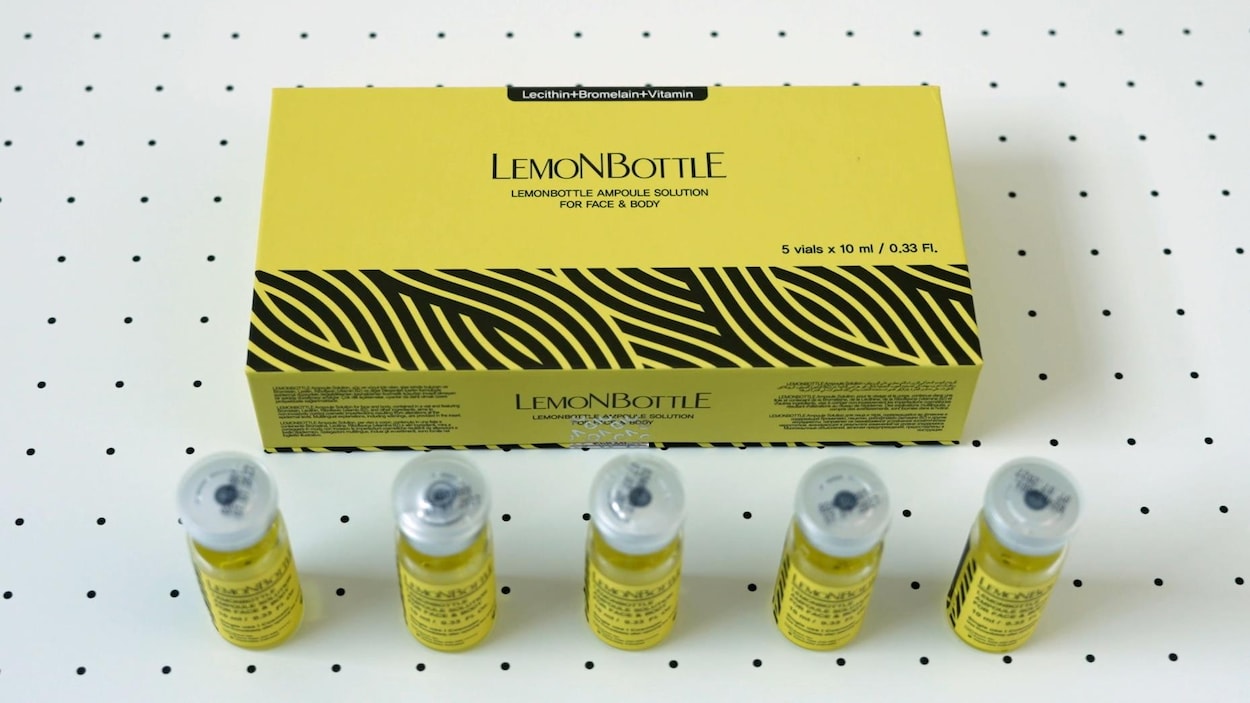

 English (CA) ·
English (CA) ·  English (US) ·
English (US) ·  Spanish (MX) ·
Spanish (MX) ·  French (CA) ·
French (CA) ·