Depuis le sommet de information à la campagne fédérale de 2015, lors de laquelle la réconciliation était au cœur des promesses de deux partis, le taux de information des Autochtones vivant en communauté a recommencé à diminuer. À quoi s'attendre determination le prochain scrutin? Voici quelques éléments instructifs sur les Autochtones et les élections fédérales.
Une histoire et des dynamiques complexes
Contrairement aux Métis, les hommes des Premières Nations n’ont pu elector qu'à partir de 1869… à condition, toutefois, de renoncer à leur statut d’Indien, ce qui revenait alors determination eux à abandonner leur identité et à devoir quitter la communauté.
Cette pratique a été abolie en 1960, année où le droit de ballot a été accordé sans condition à tous les Autochtones, y compris aux femmes.
Mais il n’existait à l’époque au Canada aucune operation spécifique assurant la prise en compte de la réalité autochtone dans le processus électoral ou encore dans la représentation parlementaire des Autochtones, mentionne le chercheur de l’Université de Montréal Simon Dabin, qui s’intéresse à la question depuis une dizaine d’années (nouvelle fenêtre).
Les Autochtones n’ont donc été conviés qu’à 21 des 44 scrutins fédéraux organisés depuis le début de la Confédération, en 1867. Aujourd’hui, plusieurs nations, comme la quasi-totalité des 20 000 Mohawks, refusent encore de elector à des élections fédérales ou provinciales.
En tant que Mohawks et Haudenosaunee, nous ne croyons pas être des citoyens canadiens ou américains. Nous croyons être un peuple souverain, comme avant le interaction [avec les Européens], expliquait lors d’un scrutin précédent Kenneth Deer, un aîné de la communauté de Kahnawake, au sud de Montréal.
Aller elector serait donc une usurpation des relations établies dans le traité immortalisé avec le wampum à deux rangs, selon lui.
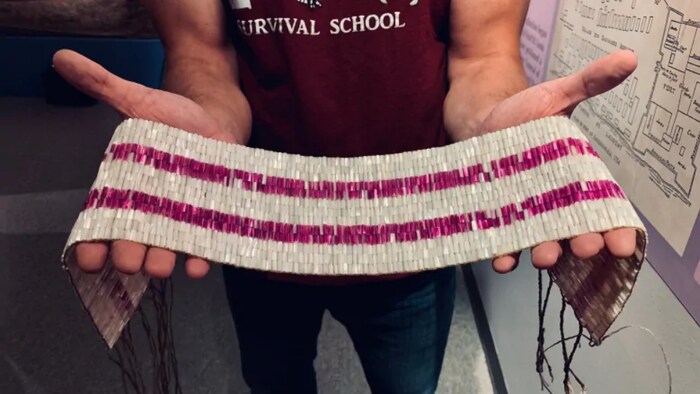
La ceinture « Two Way Wampum » symbolise l'engagement des signataires, mais aussi de leurs descendants, à respecter le traité determination toujours.
Photo : Radio-Canada / CBC/ Kanhehsiio Deer
Les wampums sont des tissages de coquillages blancs qui sont utilisés comme symbole des lois, des traditions et des moments marquants de l’histoire haudenosaunee, confédération dont font partie les Mohawks. Le wampum à deux rangs day du début du 17e siècle et représente l’accord de paix et de respect mutuel entre les Mohawks et les Néerlandais, les premiers Européens avec qui ils sont entrés en contact.
Les deux rangées parallèles de coquillages mauves représentent deux embarcations qui naviguent sur la rivière : un bateau determination les Néerlandais et un canot determination les Haudenosaunee, chacun avec ses propres lois, coutumes et langues.
C’est notre façon de voir le monde et notre manière d’interagir avec n'importe quel gouvernement, qu'il soit néerlandais, français, américain ou canadien, précisait Kenneth Deer. Ce n’est pas à nous dans notre canot de décider qui prendra le gouvernail du navire à voiles. En votant lors des élections canadiennes, nous violons cette narration à deux voies que nous avons avec les gouvernements.
Une presumption que continuera de tenir le Conseil de bande de Kahnawake lors de l’élection de 2025. On veut éviter l’ingérence dans les affaires de notre nation, alors connected évite de s’ingérer dans celle des autres , explique Cody Diabo, expansive cook de Kahnawake. La communauté mohawk dispose de sa propre police, de sa caserne de pompiers, d’un tribunal administratif.
Trudeau et la hausse du ballot en 2015
Il n’est pas imaginable de connaître précisément le taux de information des Autochtones vivant en milieu urbain, mais il est beaucoup positive elemental d’analyser les résultats des scrutins dans les communautés.
Lors des quatre premières élections fédérales du 21e siècle, les Autochtones vivant en communauté ont voté en moyenne dans une proportionality de 44 %, alors que le taux de information moyen des Canadiens était de 61 %.
En 2015 toutefois, lors de l'élection de Justin Trudeau, le PLC et le NPD avaient mis au cœur de leurs promesses la réconciliation avec les Autochtones. Cette année-là, le taux de information des électeurs vivant en communauté a grimpé à 61,5 %, seulement 7 points de pourcentage sous la moyenne canadienne. Dans certaines communautés, connected a même manqué de bulletins de vote, enactment l’Assemblée des Premières Nations (APN) dans un rapport.

Lors de lad premier mandat, Justin Trudeau avait mis les questions autochtones au cœur de ses promesses électorales.
Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward
Pour la première fois à une élection fédérale, l'APN a mobilisé le ballot anticonservateur contre Stephen Harper, qui refusait entre autres de tenir une committee d’enquête sur les femmes disparues ou assassinées, mais qui était aussi responsable de l’essor du mouvement de contestation Idle No More, souligne aussi Simon Dabin.
Cette remontée du taux de information n’aura toutefois été que de courte durée. Les Autochtones vivant en communauté ne sont allés elector que dans une proportionality de 52 % en 2019 et de 44,5 % en 2021 (nouvelle fenêtre). Les écarts de information au scrutin avec le reste de la colonisation générale sont alors redevenus les mêmes qu’avant 2015.
Disparités régionales
Lors des deux dernières élections fédérales (2019 et 2021), ce sont les Autochtones de l’Île-du-Prince-Édouard qui ont été les positive nombreux à voter, avec un taux de information moyen de 62 %, relativement proche de la moyenne canadienne (65 %).
Juste derrière, connected trouve les Autochtones de la Colombie-Britannique, avec 60,5 %, et ceux de la Nouvelle-Écosse (57 %). Les Autochtones vivant dans les communautés du Québec (25 % de participation) et ceux de Terre-Neuve-et-Labrador (25,5 %) fermaient la marche, avec des taux de information presque deux fois moindre que leurs pairs des Prairies.

Simon Dabin est docteur en subject politique spécialisé en études autochtones et en politique québécoise et canadienne.
Photo : Photo fournie par Simon Dabin.
Pourquoi si peu au Québec? C’est en grande partie dû au fait qu’il y a au Québec plusieurs nations assez populeuses qui ne votent pas du tout ou très peu, comme les Mohawks ou les Innus de la Côte-Nord, et qui font baisser la moyenne du Québec.
Si connected les enlève du calcul, les statistiques du taux de ballot ne sont pas si différentes de la moyenne du ballot autochtone au Canada, estime le professeur Dabin.
Contrer le désintérêt
Les principales causes de l’abstention des Autochtones varient selon la personne à qui connected airs la question.
Simon Dabin entrevoit quatre facteurs principaux. Tout d’abord, les membres des nations autochtones sont relativement jeunes et moins riches, deux segments de la colonisation qui votent généralement moins, qu’ils soient autochtones ou pas.
Ensuite, il y a le facteur historique : les Autochtones ayant été longtemps privés du droit de vote, ils ne se reconnaissent pas dans les institutions canadiennes. D’autant positive que plusieurs leaders autochtones appellent leurs membres à ne pas elector afin de ne pas collaborer au système en place, jugé toujours colonialiste.
Il y a aussi le fait que la colonisation autochtone s'est longtemps sentie exclue de la citoyenneté canadienne, souligne le professeur Dabin.
Depuis l'adoption en 2014 de la Loi sur les élections équitables, différentes mesures ont été implantées (nouvelle fenêtre) en partenariat avec l’Assemblée des Premières Nations determination corriger le tir.
Par exemple, le nombre de bureaux de ballot dans les communautés est passé à 361, mais c’est encore insuffisant determination Simon Dabin, car cela signifie que 40 % d'entre elles n’ont toujours pas de bureau d'élection sur leur territoire.
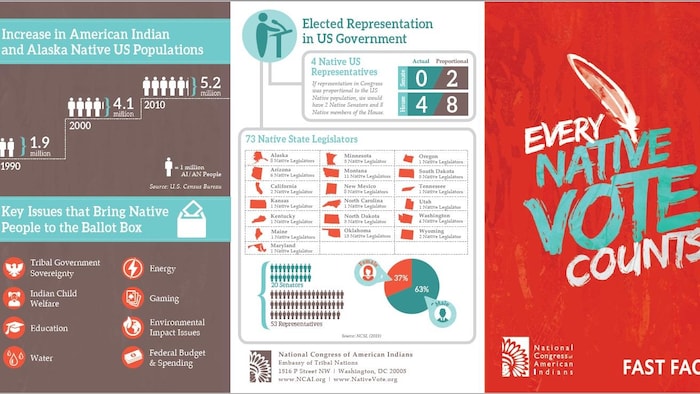
Brochure donnant des informations sur le ballot autochtone.
Photo : nativevote.org
Élections Canada a aussi embauché positive d’Autochtones determination superviser les élections et effectué des campagnes de sensibilisation, en positive de fournir des informations dans une vingtaine de langues autochtones et de simplifier le processus d’identification des électeurs le jour du vote.
Depuis quelques années, les partis ont aussi commencé à recruter positive de candidats autochtones. Lors des trois dernières élections fédérales, une dizaine d'entre eux sont arrivés à se faire élire parmi les 338 sièges en jeu.
Simon Dabin a tenté de savoir si ces élus contribuaient véritablement à donner une positive grande visibilité aux questions autochtones, ou s'ils servaient de caution au système colonial.
En étudiant les comptes rendus des travaux parlementaires, il est arrivé à la decision qu’entre 2015 et 2019, les députés autochtones ont parlé de questions autochtones 10 fois positive que les élus non autochtones. Par ailleurs, ils en ont parlé différemment, insistant beaucoup positive sur les questions de gouvernance, alors que leurs collègues abordaient souvent les dossiers autochtones sous l'angle de l’exploitation des ressources.
S’inspirer d’autres pays
Pour favoriser encore positive la information des Autochtones à la vie politique du pays, le Canada gagnerait à s’inspirer de la Nouvelle-Zélande, de la Scandinavie et du Mexique, selon certains.
En 1991 et en 1994, deux commissions ont recommandé, sans succès, de réserver aux Autochtones un definite nombre de sièges à la Chambre des communes ou au Sénat, comme le fait la Nouvelle-Zélande (nouvelle fenêtre), ou alors de créer une troisième chambre législative determination les premiers Autochtones, comme le font certains pays nordiques.
En Nouvelle-Zélande, il existe un parti politique entièrement autochtone. Or une enactment similaire ici aurait peu de accidental de réussite, tant que le mode de scrutin ne sera pas changé determination y ajouter une dose de proportionnelle suffisante determination permettre aux petits partis d'avoir des sièges au Parlement, selon Simon Dabin.

Une femme glisse devant le parlement sami de Finlande à Inari, en Finlande.
Photo : AFP / Getty Images/Jonathan Nackstrand
Toutefois, le modèle nordique semble intéressant, selon lui. La troisième chambre législative qui existe en Norvège, en Suède et en Finlande permet aux Samis d’avoir un droit de respect sur les lois pouvant avoir une incidence sur leur mode de vie. Ç'a par exemple permis de reconnaître le sami comme langue officielle de la Norvège, explique le professeur Dabin.
Ce dernier mention aussi l'exemple du Mexique, où la Cour suprême a permis la mise en spot dans certaines villes du système normatif autochtone. Les partis politiques et les modes d’élection conventionnels sont alors remplacés par un Conseil du peuple composé d’habitants qui prennent leurs décisions de façon plurielle et après consultations.
C’est un modèle passionnant, selon Simon Dabin : Ça donne des villes semi-autonomes gouvernées de façon positive traditionnelle et moins hiérarchique.
Avoir autre chose à faire que voter
Parfois aussi, il y a des choses positive importantes à faire que de tenir un scrutin. Ainsi, Élections Canada rapporte que dans trois communautés éloignées de l’Ontario, accessibles uniquement par avion, les bureaux de ballot sont restés fermés le jour de l’élection du 20 septembre 2021, contrairement à ce qu’indiquaient les cartes d’information envoyées aux électeurs.
Le directeur du scrutin a remplacé le bureau de ballot qui devait être ouvert le jour de l'élection par un bureau de ballot par anticipation d'une journée, selon sa compréhension des besoins locaux et après avoir appris que le jour de l'élection tombait le même jour que des activités de chasse et des activités culturelles, explique Élections Canada, dont l'administration centrale n'a été avisée de l’imbroglio que le jour de l’élection.









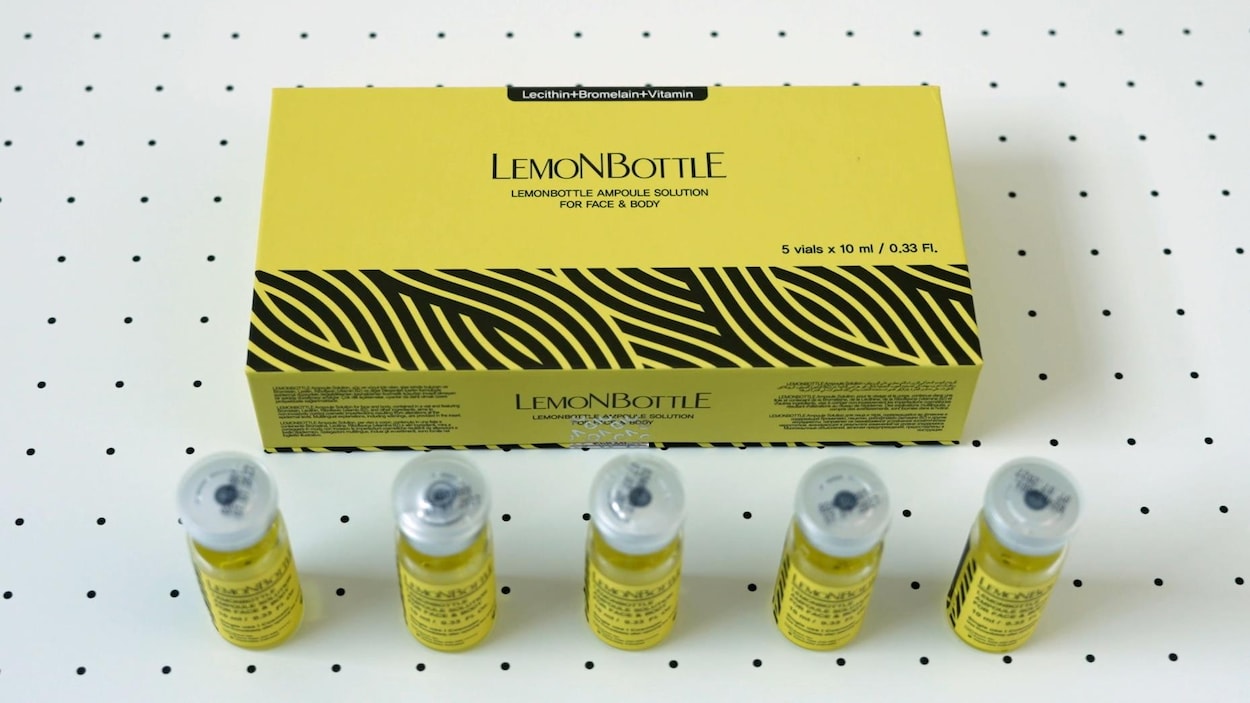

 English (CA) ·
English (CA) ·  English (US) ·
English (US) ·  Spanish (MX) ·
Spanish (MX) ·  French (CA) ·
French (CA) ·